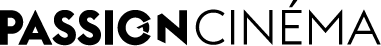Caméra-stylo, programme n°16 |

Jusqu’à ces dernières années, le cinéma d’URSS, célébré par Lénine comme «le plus importants de tous les arts», avait bénéficié de toute la puissance de l’appareil d’Etat. Nationalisé en 1919, le cinéma soviétique fut révolutionnaire (dans tous les sens du terme) dans les années vingt et jusqu’au milieu des années trente. Le pouvoir stalinien imposa par la suite une ligne de conduite beaucoup moins euphorique, prônant la propagande et un «réalisme» strictement socialiste.
Mis à part une brève période de plus grande liberté au premières armées de l’ère Kroutchev (1962-63) et quelques éclairs vite réprimés dans la longue période de «stagnation» bréjnevienne, il faudra attendre la Perestroïka de Gorbatchev pour retrouver alors une euphorie créatrice du cinéma «soviétique» similaire à celle de ses premières années.
Le cinéma russe, comme celui des Républiques soviétiques, a ainsi vécu près de septante ans sous un double régime: celui de la censure politique et de la liberté financière. Dès lors qu’un scénario était accepté par les autorités, chaque cinéaste —salarié — recevait tous les moyens nécessaire pour tourner.
La deuxième révolution
Avec la Perestroïka, dès 1986, le paysage audiovisuel soviétique s’est rapidement transformé. D’innombrables films, jusqu’alors interdits, sont sortis des placards, comme «La Commissaire», de Alexandre Askoldov, réalisé en 1967 et qui a obtenu l’Ours d’argent à Berlin en… 1988! Des cinéastes auparavant relégués dans les oubliettes de la censure se sont vus soudains réhabilités, comme Kira Mouratova, Sergueï Paradjanov, Andreï Tarkovski — à titre posthume — ou le Géorgien Otar Iosseliani; d’autres ont pu enfin librement tourner et montrer leurs films, comme Alexandre Sokourov, Nana Djordjadzé et la plupart des cinéastes présentés ici. Des groupements d’auteurs plus expérimentaux — comme le Ciné-Phantom de Leningrad autour d’Evguénï Yufit — ont imposé peu à peu des films subversifs réalisés en marge de tout système.
Une nouvelle économie
Avec la fin de la censure et la disparition du monopole de l’Etat sur le cinéma, les conditions de productions se sont inversées: autant la censure a progressivement disparu, pour se faire aujourd’hui inexistante, autant les moyens de production se sont amenuisés. Les studios ont perdu le soutien étatique pour se transformer, tant bien que mal, en entreprises privées; les cinéastes ont acquis le droit de faire des films de façon indépendante, par l’entremise de coopératives de production.
Mais c’est alors une autre censure — économique celle-là — qui est apparue. Sans économie d’Etat pour produire des films, les cinéastes de l’Est se doivent dès lors de co-produire avec l’Ouest pour pouvoir exister.
Se voir et se reconnaître
A voir leurs films, un constat s’impose. Frustrés d’images et de sujets contemporains, les cinéastes ont aujourd’hui saisi l’opportunité de décrire ce qu’ils voyaient tous les jours — la Russie telle qu’ils la connaissent, si différente de celle qu’un certain cinéma d’appareil voulait jusqu’alors la montrer —.
Ainsi des Pavel Lounguine («Taxi Blues», «Luna Park») ou Vassili Pitchoul («La petite Véra») ont- ils saisi à bras le corps cette image, filmant dans l’urgence, souvent avec des acteurs non-professionnels, des histoires de leur temps. Ce besoin de filmer correspondait aussi à un besoin de se voir, de se reconnaître enfin dans le cinéma, comme le démontre le succès sans précédent de «La petite Véra» (1988): plus d’un soviétique sur cinq ira voir le film!
Ces cinéastes, qui ont enfin pu faire des films libres, ont vécu une période de grâce qui désormais s’achève: car le cinéma de l’ex-URSS est petit à petit récupéré par le système cinématographique occidental — et américain en particulier — qui transforme les vieux studios de l’ex-URSS en succursales de Hollywood et imposera peut-être, à l’avenir, les mêmes standards, les mêmes histoires, les mêmes images que partout ailleurs. En décembre 1989 déjà, le film champion du box-office à Moscou n’était plus un film russe… mais une obscure série Z américaine, «King Kong vivant!»
Six cinéastes
Sergueï Bodrov, né en 1948 à Khabarovsk, travaille d’abord comme ouvrier et éclairagiste de cinéma. En 1971, il entre au VGIK, la célèbre Ecole de cinéma de Moscou (section scénario) dans la classe de Kira Mouratova. Une fois sorti de l’école, il fait du journalisme, tout en continuant à écrire des scénarios et des feuilletons, avant d’aborder en 1984 la réalisation. «S.E.R.» est son quatrième film.
Vitali Kanevski, né en 1935 à Soutchan, près de Vladivostok, entre au VGIK en 1960. Accusé d’un viol qu’il n’a pas commis, Kanevski passe huit ans en prison. En 1977, son diplôme de réalisateur enfin en poche, Kanevski ne trouve toutefois pas de travail… ses propres scénarios ne sont pas acceptés et il se refuse à tourner ceux des autres. Ce n’est qu’en 1989 qu’il se lance dans le tournage de «Bouge pas, meurs, ressuscite», encouragé par le réalisateur Alexeï Guerman. Kanevski parvient à montrer son film inachevé au cinéaste américain Alan Parker qui, emballé, le présente à Cannes: Kanevski y reçoit la Caméra d’or, et peut entamer le tournage de la suite de son autobiographie, «Une vie indépendante», avec des capitaux français.
Bakhtiyar Khoudoïnazarov est né en 1965 à Douchanbé, capitale du Tadjikistan. A 20 ans, comme beaucoup d’autres futurs cinéastes issus des Républiques soviétiques, il part pour Moscou étudier au VGIK. Il y tourne en particulier un moyen-métrage adapté de la nouvelle de Pouchkine Le diable. Il revient au Tadjikistan pour tourner en noir et blanc son premier long-métrage, «Bratan» (Petit frère), présenté à Nantes en 1991 et à Fribourg en 1992, où il a remporté un prix. Khoudoïnazarov vit désormais à Moscou.
Alexandre Rogojkine, né en 1949 à Leningrad, a d’abord étudié l’art et l’histoire à l’Université avant de s’intéresser au cinéma: de 1974 à 1977 il travaille comme architecte-décorateur aux studios Lenfilm, avant d’entrer lui aussi au VGIK, dont il sort diplômé en 1981. Il réalise alors un court-métrage, «La Rousse», et deux autres longs-métrages avant de tourner «Karaul», produit par les studios Lenfilm.
Nikolaï Dostal, né en 1946 à Moscou, est le seul des cinéastes présentés ici à ne pas avoir fréquenté le VGIK. Réalisateur atypique, il a d’abord étudié le journalisme et travaillé comme technicien aux studios Mosfilm, avant d’étudier à l’Ecole supérieure de mise en scène, de 1971 à 1973, pour devenir cinéaste. Son quatrième long-métrage, «Nuage paradis», constitue également un film à part dans le paysage cinématographique russe: il n’a pas été produit par un des grands studios de l’ex-URSS (Mosfilm, Lenfilm, Gorki, Dovjenko) mais en coproduction avec une société coopérative indépendante, la 12-A Films Studios; il constitue de ce fait l’un des premiers films «libres» entièrement financé en ex-URSS.
Otar Iosseliani est né à Tbilissi, en Géorgie, en 1936. Il interrompt ses études de mathématique et de musique pour entrer au VGIK dont il sort diplômé en 1961. Il est d’abord l’auteur de courts-métrages filmés sur le vif, remarqués par Georges Sadoul qui, en 1965, voit en lui le digne descendant du révolutionnaire Dziga Vertov: Iosseliani «met l’accent sur les hommes guettés par une caméra-œil attentive et pleine d’amour vrai.» Inspiré par le grand cinéaste de la terre, Alexandre Dovjenko, Iosse- liani tourne en 1967 son premier long-métrage, «La Chute des feuilles», puis en 1971 «II était une fois un merle chanteur», sur un «héros négatif», un musicien qui vit d’expédients et ne parvient pas à respecter les normes de la vie sociale. Ce film, ainsi que «Pastorale», tourné en 1976, lui valent plusieurs ennuis avec les autorités. C’est pourquoi Iosseliani décide de partir à l’Ouest, où il tourne successivement des documentaires au Pays Basque («Euskadï», 1982) et en Italie («Un petit monastère en Toscane», 1988) et des fictions en France («Les Favoris de la lune», 1984) ou en Afrique noire («Et la lumière fut», 1989).