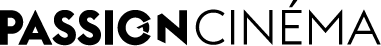Venise 1967, en compétition
de Pier Paolo Pasolini
avec Franco Citti, Sivana Mangano, Alida Valli, Julian Beck, etc.

Au panthéon du cinéma d’auteur, «Œdipe roi» (1967) brille d’un éclat singulier. «Ce film est autobiographique, je raconte l’histoire de mon propre complexe d’Œdipe. Je raconte ma vie mystifiée, rendue épique par la légende d’Œdipe.» C’est en ces termes que le cinéaste italien présente son premier film en couleur qui débute dans une ville italienne des années vingt… Un bébé très attaché à sa mère assiste à ce que Freud a appelé la «scène primitive», suscitant la rivalité jalouse de son père, un officier militaire. Cet enfant est Pasolini lui-même. D’emblée, le spectateur découvre au cours de ce prologue d’une beauté déchirante le roman «familial» qui a conditionné l’artiste dès sa prime enfance. Le bébé pleure dans son berceau en criant «maman». L’homme le saisit par les jambes… Sans avertir, Pasolini nous fait alors basculer dans le récit du mythe qui doit conjurer la «scène primitive», effectuant l’une des ellipses les plus saisissantes de l’histoire du cinéma, aussi puissante que celle de «2001: l’odyssée de l’espace» de Kubrick… S’inspirant du chef-d’œuvre de Sophocle (écrit et joué entre 430 et 415 avant Jésus-Christ), le réalisateur nous transporte sur le flanc du mont Cithéron où Œdipe doit être mis à mort pour faire échec à l’oracle. L’enfant est sauvé. Les faits qui s’ensuivent sont connus, inéluctables. Après avoir accompli à son insu la prédiction, apprenant la vérité intolérable sur ses origines, Œdipe adulte se crèvera les yeux… Dans un épilogue ancré dans les années soixante, on découvre Œdipe aveugle, qui chemine au bras d’un jeune homme, revenant vers la maison natale de Pasolini, désormais emplie de «l’énorme songe du mythe». Avec ses anachronismes, de l’ordre du syncrétisme révélateur, ce film à nul autre pareil déjoue complètement le piège psychanalytique et débouche sur un portait intime bouleversant.
EDIPO RE, Italie / Maroc, 1967, couleur, 1h50, programme n°157