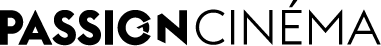Caméra-stylo, programme n°17 |

Depuis 1990, et malgré son récent Oscar à Hollywood, Federico Fellini n’a pu tourner que quelques films publicitaires… comme si, au temps du rêve désincarné de la télévision, le spectacle de la décadence auquel il nous confronte depuis quarante ans — de façon ô combien jouissive — n’avait plus sa place. Et pourtant!… jamais ses films ne se révèlent aussi pertinents qu aujourd’ hui!
Ainsi certains cinéastes éprouvent-ils le besoin de trouver, dans d’autres arts, non pas de «nouvelles histoires» à raconter, mais de «nouvelles manières» de les raconter.
Né en 1920 à Rimini, Federico Fellini a d’abord passé par le journalisme et la caricature avant d’être entraîné vers le cinéma par Roberto Rossellini, qui le pousse à écrire des scénarios pour lui. Ainsi, de Rome ville ouverte à Europe 51, Fellini collabore- t-il, dans l’immédiat après-guerre, à l’émergence du du «néo-réalisme».
Néo-réalisme?
Pour les cinéastes italiens de l’époque comme Rossellini, bien sûr, mais aussi Vittorio de Sica, Giuseppe de Santis, Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni (à leurs débuts), il s’agit de quitter le rêve des studios de Cinecittà (fondés par Mussolini) pour filmer dans la rue un «état des lieux» de l’après-fascisme, pour se remettre à croire en l’humanité après la guerre et les camps de la mort.
Les personnages qu’ils croisent devant leurs caméras sont pauvres, désoeuvrés, marginaux; sans une place établie d’avance par la société, ils déambulent en observateurs dans les terrains vagues, à contempler le monde. C’est à la manière d’un de ces personnages néo-réaliste que Fellini aborde le cinéma: l’observateur, c’est lui, et le terrain vague de sa caméra deviendra, de plus en plus, celui de sa mémoire. Ainsi, dès ses premières armes de réalisateur, et même s’il souscrit aux idées néo-réalistes, Fellini s’en éloigne peu à peu: ce qui l’intéresse, c’est moins le spectacle du monde, en tant que tel, que le monde qui se donne en spectacle.
Les feux de l’illusion
Dans ses deux premiers films, «Le Luci del varietà» (co-réalisé avec Alberto Lattuada, 1951) et «Lo Sceicco bianco» (1952) la vision de la «réalité» italienne transite par les illusions du music-hall ou les fantasmes du roman-photo.
Dans «La Strada» (1954), qui lui vaudra une Palme d’or à Cannes et son premier Oscar à Hollywood, les personnages qu’il décrit sont moins des «marginaux» issus d’un tissu social défini que les créatures du cinéastes, figures enfarinées du cirque ambulant de son enfance. De plus en plus ses personnages deviennent des «caricatures», comme celle qu’il dessinait pour son journal; c’est-à-dire sans autre psychologie que celle de leur auteur.
Après «Le Notti di Cabiria» (1957), Fellini vient s’installer à Cinecittà — cet univers de l’illusion qu’il ne quittera plus — pour y tourner la mythique «Dolce vita» (1960) où il décrit pour la première fois les errances romaines de son alter ego, Marcello Mastroianni, et «Otto e mezzo» (1963), au titre qui ne dit rien d’autre que ce qu’il est: son huitième film et demi.
Pas besoin d’en dire plus, car «Otto e mezzo» est un film de, et sur Federico Fellini en tant qu’auteur. Le cinéaste ne fait plus de différence entre un monde qu’il observe et sa vision subjective; il se projette entièrement dans son œuvre; et le récit s’ordonne par mouvements successifs au fil de ses fantasmes et de sa mémoire.
Jouir de la décadence
A partir de là, Fellini semble ne s’attacher qu’à la décadence, celle de l’homme, des corps, des civilisations: car pour lui cette étape obligée de la vie, où les limites sociales et les barrières psychologiques s’estompent, est peut-être la meilleure de toute existence; à l’instar des bacchanales de l’Antiquité, le spectacle de la dégradation et de la décadence est pour lui intensément jouissif, dégageant une énergie folle qui explique peut-être pourquoi l’Italie, en déréliction permanente, survit toujours aussi bien. Qu’il reconstitue dans les studios de Cinecittà la Rome antique de Pétrone dans «Satyricon» (1969) ou la «Roma» de ses souvenirs (1972), aucun autre repère ne résiste que celui d’une association libre d’émotions et d’interprétations, à l’instar du «je me souviens» dialectal qui sert de titre, crypté, à «Amarcord» (1973).
Seule la musique guide le spectateur à travers la mémoire et les visions de Fellini, dans un monde visuel et sonore chaotique, où la post-synchronisation lui permet de transformer les dialogues en rumeurs, amalgames de bruits, de mots et de voix. Les ritournelles des compositeurs Nino Rota et aujourd’hui Nicola Piovani passent par dessus les plans et les séquences; elles organisent le mouvement du film comme le spectacle d’un monde, celui de la subjectivité.
Le spectacle universel
«Le spectacle devient universel et ne cesse de croître», disait Fellini à propos du monde et de son prétendu relais, la télévision. C’est pourquoi le cinéaste, à travers «Ginger e Fred» (1986), évoque moins le cinéma (Ginger Rogers et Fred Astaire) que cette télévision devenue horrible, incapable de s’arrêter un instant sur le spectacle de la décadence de deux vieilles stars des claquettes. Mais ce spectacle, pour atroce qu’il soit, n’en est pas moins intensément positif, et entraîne le cinéaste à résister au «village global» de la télévision. Cette résistance, Fellini la prouve encore dans «Intervista» (1987), un «filmetto» prévu à l’origine pour la télévision, et surtout «La Voce della luna», son dernier film en date (1990), où il nous prodigue un cours de sagesse halluciné.
Sous les sunlights de Hollywood, Federico Fellini vient donc de recevoir un Oscar pour l’ensemble de son œuvre, qui compte désormais vingt longs-métrages, plusieurs courts-métrages et quelques pubs; mais personne ne semble pour autant disposé à financer son nouveau film. Peut-être parce que, comme l’écrivait Fellini, «le seul véritable réaliste est le visionnaire»; et que le réalisme de ses visions empêchent encore un peu les faiseurs de rêves cathodiques de tourner en rond.
Frédéric Maire