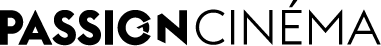Caméra-stylo, programme n°143 |
Au jour d’aujourd’hui, ce que l’on désigne sous le vocable de «Nouvel Hollywood» considère la production de film comme une activité secondaire, au mieux un produit d’appel pour faire vendre des marchandises qui n’entretiennent plus qu’un lointain rapport avec le cinéma. L’ancienne Mecque du septième art s’est recyclée dans l’industrie mondialisée des loisirs. Comment en est-on arrivé là? Les spécialistes en la matière retiennent deux dates charnières pour situer la genèse de ce phénomène qui n’est pas sans incidence sur la médiocrité actuelle des blockbusters. En 1953, un décret «antitrust» interdit aux Majors de posséder des salles. Cette mesure va contraindre les décideurs hollywoodiens à se diversifier. Le 17 juillet 1955, Walt Disney inaugure en grande pompe Disneyland, un parc d’attractions qui suscite un engouement sans précédent. L’événement est retransmis en direct à la télévision. Mais Disney reste un précurseur isolé. Les nababs qui ont pignon sur Hollywood Boulevard ne vivaient que pour et par le cinéma. Contrairement à l’Oncle Walt, ils n’avaient que peu de goût pour le marchandisage!
Walt Disney en précurseur
Les dynasties (souvent) familiales qui ont régné sur «l’usine à rêves» pendant cinq décennies doivent alors céder le pas à des multinationales qui les intègrent dans leur consortium. Les véritables producteurs sont remplacés par des administrateurs qui n’ont aucune passion pour le cinéma. L’âge d’or personnifié par les Irving Thalberg, Arthur Freed, Dore Schary et autre Hall Wallis est révolu. Les auteurs, au sens européen du terme, ont bien évidemment pâti de cette nouvelle donne. Autrefois, ils parvenaient à exister dans une logique de perpétuel affrontement avec un système visant depuis toujours à éradiquer tout apport personnel. Aujourd’hui, ils ne suscitent guère que l’indifférence, voire le mépris. Certains ont repris espoir en octobre 1994 avec la création de Dreamworks, une société de production et de distribution «multimédia» dont le secteur cinéma était dirigé par Steven Spielberg. Cette structure indépendante et ambitieuse a hélas fait long feu. En décembre 2005, la Paramount Pictures, la plus réactionnaire des sept Majors en activité, rachetait la société frondeuse pour 1,6 milliards de dollars.
Une affaire qui marche
Cette évolution du marché est certes fructueuse sur le plan économique (après l’aéronautique, l’industrie audiovisuelle est la deuxième source d’exportation américaine), mais néfaste sur le plan artistique. Hormis une poignée de vétérans qui savent encore en imposer (East-wood, Michael Mann, Spielberg, De Palma, Scorsese, etc.), les réalisateurs qui composent avec le Nouvel Hollywood sont pour la plupart engloutis dans un anonymat médiocre. Exception faite de Sam Raimi (la saga «Spider-Man»), Steven Sorderbergh et Peter Jackson, tous les cinéastes qui gênent la «machine» doivent prendre la tangente et s’autoproduire à moindre coût, tels Gus Van Sant, Abel Ferrara, James Gray, Larry Clark, David Cronenberg ou Quentin Tarantino. D’autres, comme David Lynch ou Julian Schnabel, s’exilent sous des cieux plus cléments (la France) et refont en sens inverse la traversée que maints réalisateurs européens accomplirent dès les années vingt (Stiller, Sjöström, Murnau, Lang, Curtiz, Siodmak, Hitchcock, Wilder et tant d’autres), contribuant avec leur génie singulier au grand rêve hollywoodien… Ironie de l’Histoire!
Vincent Adatte