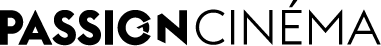Caméra-stylo, programme n°25 |

Fils cadet d’une famille de sept enfants, Akira Kurosawa est né en 1910 à Tokyo. Son père, descendant d’une longue lignée de samouraïs et militaire de carrière, contraint Akira à une discipline de fer; très attaché aux traditions japonaises, il intéresse aussi son fils à la culture occidentale: il emmène Akira au théâtre, au music-hall et, surtout, au cinéma. Cette éducation, à la fois rigoureusement japonaise et ouverte sur le monde, va profondément influencer Kurosawa. Parvenu à l’adolescence, le futur cinéaste s’intéresse naturellement aux Beaux-Arts. Il étudie le dessin et la peinture, activités qu’il ne cessera jamais d’exercer par la suite.
Initiations
Pendant ce temps, son frère Heigo, de cinq ans son aîné, qui travaille comme Benshi (littéralement «homme parlant») dans les cinémas et commente à haute voix les films muets, le prend sous sa protection. Entre 1920 et 1934, il lui permet de découvrir tous les plus grands cinéastes de l’époque, américains et européens en particulier. Grâce à lui, Akira s’initie également à la littérature japonaise et occidentale; il découvre en particulier l’œuvre de Dostoïevski, que l’on retrouvera plus tard dans plusieurs de ses films.
En 1935, sept ans après l’avènement du cinéma parlant, la prestigieuse profession de Benshi a perdu tout son sens; Heigo se rend un soir dans la montagne et se suicide.
Cet événement, même s’il n’est pas rare dans la tradition japonaise qui professe volontiers le «sacrifice de soi», marque profondément Akira, qui décide de prendre — à sa manière — la succession de son frère: il répond à une offre d’emploi du Photo Chemical Laboratory, un studio de cinéma, qui recherche des assistants réalisateurs; la culture cinématographique, littéraire et picturale très complète dont il fait état lui permet d’être immédiatement embauché.
Le cinéaste en herbe devient très vite un orfèvre de l’écriture de scénarios. Kurosawa écrit d’abord beaucoup pour les autres, avant de se décider, en 1941, à réaliser lui-même un de ses scénarios.
Mais les temps sont durs: la guerre impose aux artistes une censure très stricte. Kurosawa se fait refuser projet sur projet jusqu’au jour où il parvient enfin à convaincre les militaires du bien fondé de «La Légende du grand Judo» (1943), un «Jidai-Geki» ou fresque historique — genre très prisé par les Japonais — qui narre l’initiation d’un jeune judoka.
Amputé par la censure militaire qui juge le film trop sentimental, «La Légende du grand judo» connaît tout de même un grand succès commercial au Japon.
Tradition et Occident
Kurosawa alterne dès lors des films plus historiques comme l’ironique «La Queue du tigre» (1945), où il met en cause une certaine dérive des traditions japonaises, et des «Gendai-Geki» (littéralement «théâtre contemporain»), mélodrames ou films noirs inspirés par des romans policiers, qui traitent de sujets modernes et occidentaux: en particulier «Je ne regrette rien de ma jeunesse» (1946), «L’Ange ivre» (1948) — où apparaît pour la première fois son acteur fétiche, Toshiro Mifune — et «Chien enragé» (1949, d’après Simenon).
En 1950, Kurosawa tourne «Rashomon» qui rencontre un succès considérable, tant au Japon qu’à l’étranger; le cinéaste a dès lors les mains libres. En alternance avec des sujets plus contemporains qu’il écrit lui-même, il adapte Dostoïevski («L’Idiot», en 1951), Shakespeare (Macbeth avec «Le Château de l’araignée», 1957), Gorki («Les Bas-fonds», 1958). De cette époque datent certains de ses plus grands films: ceux qu’il l’ont rendus célèbre dans le public occidental, comme «Les sept samouraïs» (1954), mais aussi «Vivre» (1952, que Kurosawa considère comme son meilleur film) ou «Barberousse» (1965), dernière œuvre qu’il tourne avec Toshiro Mifune.
Un cinéma éthique
A travers son cinéma, profondément éthique, Kurosawa met en scène l’initiation, la prise de conscience de soi, l’acceptation de ses responsabilités. Kurosawa se méfie du traditionnel «esprit collectif» japonais, et privilégie au contraire des destins individuels, plus à même de montrer, selon lui, les drames du Japon contemporain: les contradictions inhérentes à l’après-guerre, la perte des traditions confrontée au modernisme effréné de la «reconstruction» et à l’influence occidentale.
Tant et si bien que les Japonais l’accusent de faire des films qui n’ont plus rien de japonais et le rejettent. En 1970, Kurosawa subit l’échec commercial de «Dodes’kaden», pur chef d’œuvre; aucun producteur japonais ne veut travailler avec lui. En 1971, il tente même de se suicider.
Ce n’est que grâce aux Russes, qui l’invitent à tourner «Dersou Ouzala», qu’il peut recommencer à travailler. Ensuite, il faudra que les occidentaux s’en mêlent pour que Kurosawa, enfin, nous revienne d’entre les exclus. Ce sont ses admirateurs étrangers, les cinéastes américains Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese ou le producteur français Serge Silberman qui lui permettront de réaliser «Kagemusha» (1980, Palme d’Or à Cannes), «Ran» (1985, d’après Le roi Lear, de Shakespeare), «Rêves» (1990) «Rhapsodie en août» (1991) et aujourd’hui «Madadayo».
Cinéaste de l’espace
Attaché à la conception japonaise du monde, qui définit l’individu d’abord par la ville où il habite, puis par le quartier, le pâté de maison, l’édifice, Kurosawa est d’abord un metteur en scène de l’espace général: un espace à la fois physique et mental (Kurosawa passe volontiers du réel aux rêves), presque théâtral; un espace dans lequel, ensuite, il décrit les individus particuliers.
A travers des mouvements d’appareils latéraux, souvent très rapides, ou l’enchaînement de plans larges et de très gros plans, le cinéaste met alors en scène le passage de la situation à l’action, du questionnement à la réponse: une réponse souvent morale, qui se dégage d’elle-même de l’action lorsque l’individu comprend son environnement — la vie et la nature, en particulier, si présentes dans ses films.