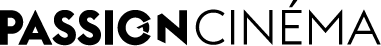Caméra-stylo, programme n°10 |

Né en 1957 à Orimattila, en Finlande, Aki Kaurismäki suit d’abord des études de communication avant de se tourner vers le cinéma. Passionné par le septième art, il se gave de films à la Cinémathèque d’Helsinki et travaille comme critique de cinéma. En 1980, il joue dans «Le Menteur», le premier film de son frère aîné Mika — réalisateur, entre autres, de «Helsinki Napoli». L’année suivante, ils réalisent ensemble «Saimaa-ilmiö», un reportage-fiction sur le rock en Finlande, avant de fonder leur propre société de production, Villealfa. Cette dénomination s’inspire du film de Jean-Luc Godard, «Alphaville», que Aki affectionne tout particulièrement. Godard est d’ailleurs l’un de ses cinéastes favoris, avec Robert Bresson, Yasujiro Ozu, Jacques Becker et Samuel Fuller qui, comme par hasard, joue un petit rôle dans «La Vie de bohème». Dès son premier film, «Crime et châtiment» (1983), il balise un territoire cinématographique qui se révélera lui appartenir pleinement, et dont «I Hired a Contract Killer» (1990) et «La Vie de bohème» (1992) constituent l’aboutissement.
Trilogie prolétarienne
Aki Kaurismâki s’est d’abord attaché à décrire la réalité finlandaise: sa «trilogie prolétarienne» débute en 1986 avec «Shadows in Paradise», l’histoire malheureuse d’un éboueur amoureux d’une caissière de supermarché; elle continue en 1988 avec «Ariel», qui narre la dérive d’un chômeur sans-le-sou et
sans espoir; et s’achève l’année suivante avec «La Fille aux allumettes», (mélo-)drame de la solitude. Trois films qui commencent chacun par une longue séquence de caractère presque documentaire (le travail de l’éboueur, le constat du mineur licencié, ou la fabrication industrielle des allumettes); la fiction venant seulement après, comme surgie d’un matériau profondément ancré dans a réalité.
L’épure et l’ellipse
Sous ses apparences ironiques, distantes peut-être, c’est à un cinéma de la souffrance — du froid, du vide — éloigné de toute «civilisation» que nous confronte Kaurismäki; un cinéma qui rêve d’un ailleurs riche et
chaleureux, où les mélos pourraient enfin ne plus tourner au drame. Kaurismäki a très vite porté ses films sur le mode de l’épure, de l’ellipse; ses récits (qui durent rarement plus d’une heure et quart) semblent vouloir ne montrer que l’essentiel, l’indispensable, comme s’il faisait trop froid pour en rajouter, comme s’il y avait aussi urgence d’en finir: en finir avec le froid, en finir avec la Finlande… et passer à autre chose.
Ses adaptations très contemporaines de grands classiques de la littératures («Crime et châtiment» d’après Dostoïevski, «Hamlet Goes Business» d’après Shakespeare ou «Les Mains sales», d’après Sartre, pour la télévision) et les films de la trilogie («Shadows in Paradise», «Ariel» et «La Fille aux allumettes») constituent ainsi une série d’études sur le malaise finlandais. Films brefs, secs, efficaces et redoutables sur la misère (physique et morale) des gens de là-bas, sur leur détresse et leur désir d’en sortir.
Les personnages de Kaurismäki ont tous, toujours, envie de partir. Toutefois, le départ ne se révèle souvent qu’un rêve (triste), qui, même s’il se réalise à l’image, ne semble jamais s’actualiser.
Le «rêve américain»
Comme s’il avait fallu qu’il fasse lui-même l’expérience de cet «état de rêve» et de fuite, Kaurismäki a renoué avec la veine plus comique de l’un de ses premier films, «Calamari Union» (1985) — dérive délirante d’un clan de dix-huit fêtards à Helsinki — dans «Leningrad Cowboys Go America», qu’il tourne parallèlement à «La Fille aux allumettes» (1989): ses personnages passent enfin du froid au chaud, de l’Oural au Mexique. Là-bas, le cinéma glacial du finlandais fond comme neige au soleil. Le rêve — réalisé — est devenu burlesque… la quête d’un ailleurs plus chaud que la Finlande a disparu; comme les personnages, la caméra se déplace alors sans but, du côté des errances de Jim Jarmusch qui fait, à son tour, une petite apparition dans le film.
Nouvelle terre
Comme s’il avait ainsi exorcisé son fantasme hollywoodien (et son amour des séries B), Kaurismäki s’en revient alors en Europe. Il trouve en Angleterre et en France, à mi-distance entre son pays et le rêve (américain), sa terre d’élection: il engage un tueur pour Jean-Pierre Léaud, chômeur solitaire qui désire se suicider, ou (dé)chante «La Vie de bohème» de quelques artistes perdus à Paris, au bord de la misère. Dès lors son cinéma s’en trouve sublimé, alliage parfait du réalisme des contenus et de l’abstraction, sobre ou flamboyante, des contenants. Car aux préoccupations «sociologiques» qui sous-tendaient par exemple sa trilogie, fait place désormais une réflexion (déjà présente, en filigrane, dans la plupart de ses films) sur le cinéma et la représentation en tant que tels, ainsi qu’une étude très personnelle et intime des ressorts de l’âme humaine.
Etrangers à Londres comme à Paris, le chômeur français, le peintre albanais ou le musicien irlandais sont autant de déracinés qui bafouillent leurs désirs et cherchent à communiquer — comme le cinéaste finlandais — leur propre essence aux autres. A la manière de ces artistes paumés qui vivent (ironiquement) leur «Vie de bohème» dans le Paris de Carné et Prévert, Kaurismäki — qui habite aujourd’hui au nord du Portugal — compte désormais sur des lendemains qui chantent, malgré tout. Sous les larmes de ses personnages paumés, sous les drames de leurs destins chaotiques, le cosmopolite du cinéma recherche aujourd’hui des bribes de vie et de bonheur, les illuminations simples et universelles de l’existence humaine.
Frédéric Maire