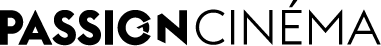A voir dimanche 13 avril 2014 à 0h15 sur France 3 |

Acteur adulé dans les années trente, Vittorio de Sica (1901-1974) a réalisé dans l’Italie en reconstruction de l’après-guerre quatre chefs-d’œuvre emblématiques du néoréalisme: «Sciuscià» (1946), «Le Voleur de Bicyclette» (1949), «Miracle à Milan» (1951) et «Umberto D (1952), qui sont les fruits exceptionnels de sa collaboration avec le scénariste Cesare Zavattini, considéré à juste titre comme le théoricien du mouvement néoréaliste. Juste avant cette rencontre décisive, De Sica réalise quatre films, dont «Un Garibaldino al convento».
Blessé au bras, un partisan garibaldien trouve refuge dans un couvent qui abrite un collège pour filles. Mettant entre parenthèse leurs querelles petites-bourgeoises, Caterinetta et Mariella se dévouent entièrement au fugitif. Mais les religieuses finissent par avoir vent de la présence de l’intrus et décident de le dénoncer aux Bourbons. Heureusement, le partisan peut compter sur l’aide des chemises rouges pour s’enfuir…
Considéré comme un film mineur dans l’œuvre de Vittorio de Sica, «Un Garibaldino al convento» contient pourtant deux spécificités qui le rendent particulièrement intéressant. En 1942, l’Italie est en train de perdre la guerre, mais le régime fasciste, encore fermement au pouvoir, applique une censure extrêmement stricte sur les arts. Aussi, l’on s’explique mal comment un scénario comme celui-ci, vecteur de valeurs révolutionnaires, a pu sortir sans être amputé de nombreuses séquences ou carrément détruit.
En outre, De Sica opère une rupture de ton significative entre la première et la seconde partie, quittant un univers léger, constitué d’amourettes et de prises de bec, pour plonger dans une dimension bien plus dramatique. Cette rupture ne sert pas seulement la narration, mais elle contient les marqueurs de deux courants cinématographiques italiens. D’un côté, la période dite des «Telefoni Bianchi» (1937-1944), que le film revisite façon «film à costumes», et de l’autre, le néoréalisme (1944-1955), que le cinéaste portera bientôt aux nues.
Durant cette première période, le cinéma italien est majoritairement constitué de comédies légères et de romances à l’eau de rose dans lesquelles apparaissent constamment ces fameux téléphones blancs, symboles de bonne santé financière et de modernité. Conçus comme de purs divertissements, ces films occultaient complètement le contexte fasciste dans lequel était plongé le pays pour se calquer sur le modèle des productions de l’usine à rêves hollywoodienne. S’il n’y a évidemment aucun téléphone dans le film de De Sica, la première partie de l’histoire conserve les tics scénaristiques de cette brève mode cinématographique avant de basculer vers une noirceur annonciatrice du néoréalisme.
de Vittorio De Sica
Italie, 1942, 1h23