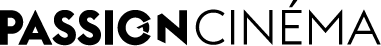Caméra-stylo, programme n°87 |

Prix du Jury pour «Le tableau noir» de Samira Makhmalbaf, Caméra d’or pour «Un temps pour l’ivresse des chevaux» de Bahman Ghobadi, Lion d’or à Venise pour «Le cercle» de Jaffar Panahi… Les représentants d’une nouvelle génération de cinéastes iraniens font déjà leur grande entrée sur la scène internationale, alors que le public occidental vient à peine de prendre toute la mesure du cinéma fabuleux des «anciens», les Kiarostami et autre Makhmalbaf. En Iran, le septième art est déjà une longue histoire, du premier film «persan» tourné le 18 août 1900 sur la plage d’Ostende en Belgique par le photographe du Shah Mozaffar al-Din, aux premières tentatives de réconcilier fiction et réalité menées à la fin des années soixante par des cinéastes aussi essentiels — et aujourd’hui oubliés — que Ibrahim Golestan ou Sohrab Shahid Saless, qui préparent l’«avènement» d’Abbas Kiarostami, véritable figure tutélaire du jeune cinéma iranien d’aujourd’hui.
Kiarostami le résistant
Palme d’or à Cannes en 1997 avec «Le Goût de la cerise», Kariostami tourne ses premiers courts-métrages dès 1970; ouvrant la voie de la reconnaissance occidentale au cinéma iranien avec «Où est la maison de mon ami» (1987), l’auteur de «Et la vie continue» (1992). Très surpris, le public européen découvre petit à petit une œuvre à nulle autre pareille peuplée d’enfants — les seuls personnages admis sans (trop) de problème par les censeurs du fait de leur «innocence» — qui remet complètement en jeu le statut de la représentation cinématographique. En butte à la censure du pouvoir khomeyniste dès 1979, après avoir enduré celle du Shah, Kiarostami fait du cinéma une admirable machine de résistance dont la forme, interrogative et paradoxale, à la fois déjoue les interdits (il est exclu de voir un homme et une femme se toucher) et renouvelle le cinéma tout court. Dans le même temps, il favorise les débuts de nombreux jeunes réalisateurs dont, notamment, Jaffar Panahi et Bahman Ghobadi.
Une nouvelle donne économique
En mai 1997, l’élection du président réformateur Mohammad Khatami, ancien ministre de la culture et de l’orientation islamique a pour effet d’assouplir (un peu la censure), une véritable aubaine pour les cinéastes de la nouvelle génération qui vont pourtant rapidement déchanter. Le cinéma d’auteur iranien vacille en effet sur ses bases, car les autorités privilégient désormais la carte du succès commercial et s’efforcent de copier les modèles de distribution et de production hollywoodiens — un signe qui ne trompe personne: lors du dernier Festival de Téhéran (en février dernier), la plupart des invités sont des représentants de l’industrie cinématographique américaine (et asiatique). Les cinéastes débutants qui se refusent à jouer ce «nouveau» jeu doivent financer leurs films à leur compte ou alors faire jouer des relations à l’étranger; Si Samira Makhmalbaf peut coproduire son incroyable «Tableau noir» avec l’Italie grâce à l’«aura» de son père, Bahman Ghobadi, lui, se voit obligé de récolter des fonds auprès des habitants du village kurde où il tourne son sublime «Un Temps pour l’ivresse des chevaux».
Du centre à la périphérie
Mais les jeunes représentants de la nouvelle génération du cinéma iranien savent s’unir pour mieux résister: Bahman Ghobadi joue par exemple le rôle de l’un des deux instituteurs du film de Samira Makhmalbaf. Ainsi, se développe peu à peu une sorte de communauté d’intérêts et de sensibilités d’une forme inédite qui explique certaines parentés thématiques. Tant le film de Ghobadi que celui de Makhmalbaf situent leur action dans la région de la frontière entre l’Irak et l’Iran et s’attachent à décrire une minorité kurde ballottée par les aléas de l’histoire et dont les enfants sont les premières victimes — comme à Bogota, Vukovar ou Manille. En déplaçant le centre vers la périphérie oubliée (répétant en cela le geste fondateur de Kiarostami), ils s’interrogent sur l’identité réelle d’un Etat-nation dont les minorités forment une véritable mosaïque culturelle — Arméniens, Kurdes, Azéris, Turkmènes, Baloutches, sans oublier les immigrés afghans (près de deux millions) qui, à leur tour, sont en train de gagner leur droit de cité sur le grand écran.
Vincent Adatte