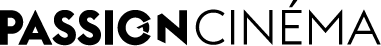Asghar Farhadi avait déjà remporté l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur pour «A propos d’Elly». Cette année, il est reparti du Festival de Berlin avec l’Ours d’Or du meilleur film et un Ours d’Argent pour l’excellente performance de l’ensemble des comédiens de « Nader et Simin, une séparation». Deux récompenses amplement méritées, tant le cinéaste sait dépeindre avec une urgence subtile et une vitalité étourdissante les disfonctionnements et privations qui minent son pays.
Comme le titre l’indique, Nader et Simin se séparent: elle veut divorcer et lui aimerait la retenir, tandis que leur fille ne sait quel camp choisir. Alors que Simin se réfugie auprès de sa famille, Nader engage une jeune femme pour prendre soin de la maison et de son vieux père, atteint d’Alzheimer. Lorsqu’un soir il retrouve son père au pied du lit, semi inconscient après la chute, il décide de congédier la jeune femme. Irrité par ses explications et prières insistantes, il finit par la pousser hors de l’appartement. Elle chute alors dans l’escalier, ce qui entraîne une fausse-couche. A partir de là, le film s’attelle à disséquer les profondes inégalités de la société iranienne avec un réalisme et une immédiateté inédite.
Si le divorce n’est plus tabou aujourd’hui en Occident, c’est loin d’être le cas en Iran. La séparation évoquée par le titre renvoie d’abord à celle qui divise l’homme et la femme, leur attribuant des rôles sociaux distinctifs. La séparation est aussi celle des idées: le désir de liberté, d’émancipation et d’exil pour elle, la nécessité d’avoir le dessus, de garder la face et préserver son rang pour lui. Enfin, le film aborde d’autres disparités sociales, comme les clivages économique et culturel qui séparent la famille de Nader et Simin de celle de la jeune femme et de son mari chômeur. Si les premiers font preuve d’un standard de vie aisé, d’une véritable modernité dans les pratiques quotidiennes et d’un certain libéralisme face aux préceptes religieux, les seconds, issus d’une classe sociale plus défavorisée, sont aussi plus conservateurs et regardants des doctrines religieuses.
Pour faire entendre leurs discordes et réclamer leurs droits, Nader et Simin d’abord, les deux familles ensuite, font appel à la justice. Ponctuant le récit, ces scènes d’audience ne font qu’exacerber les inégalités qui séparent les protagonistes. Le cinéaste dénonce un système juridique expéditif et à l’emporte-pièce, qui privilégie une rhétorique habile à un examen de la véracité des faits. Il n’en reste pas moins qu’en parallèle à cette justice officielle, au-delà des conventions sociales, il y a la justice intime: celle de la fille de Nader, qui veut savoir si son père ment ou dit la vérité; si son père a commis ou non un acte répressible. En fonction de cela, elle décidera si elle continue d’espérer la réconciliation de ses parents, ou si elle préfère suivre sa mère dans l’exil. Un film virtuose, révoltant et désespérément humain.
Jodaeiye Nader az Simin
de Asghar Farhadi
Iran, 2010, 2h03
à voir à La Chaux-de-Fonds