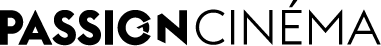de Nagisa Oshima
avec Yuzuke Kawazu, Miyuki Kuwano, Yoshiko Kuga, Fumio Watanabe, etc.

Au début des années 60, les grands studios japonais sont à l’agonie. Les auteurs humanistes connaissent un déclin public inéluctable. Des maîtres comme Mizoguchi, Naruse ou Ozu se sentent de plus en plus en décalage avec une société de consommation effrénée qui sonne le glas de leur idéal de «l’homme moral», lui substituant le modèle de «l’homme de désir» qui ne correspond guère à leurs aspirations. Dans un ultime sursaut, les dirigeants de la Toei, de la Nikkatsu ou encore de la Toho donnent alors leur chance à une poignée de jeunes cinéastes. Ils le regretteront amèrement, car les films des Imamura, Yoshida, et autre Terayama sont autant de coups de boutoir assénés contre l’establishment, même s’ils se révèlent très rentables dans un premier temps… Spécialisée dans les drames domestiques féminins, les «tsuma-mono», littéralement les «films d’épouse», la Shochiku engage Nagisa Oshima. Après un premier long-métrage remarqué, le futur auteur de «L’Empire des Sens» (1976) donne avec «Contes cruels de la jeunesse» (1960) son premier chef-d’œuvre…
Sur fond de manifestations estudiantines s’insurgeant contre le pacte de sécurité liant encore plus le Japon aux Etats-Unis, deux jeunes gens désœuvrés se lient pour le meilleur et pour le pire. Issue d’un milieu social aisé, Makoto étudie vaguement et passe son temps à séduire des hommes mûrs. Délinquant à la petite semaine, Kiyoshi vit de combines plus ou moins louches. Ensemble, ils montent une entreprise de chantage au viol qui les conduira à leur perte… Admirateur de Godard, dont il venait de découvrir «A bout de souffle» (1959), Oshima montre déjà le monde comme un lieu d’aliénation où l’on ne peut pas vivre en restant soi-même. Malgré la plénitude du format Scope, aucun de ses personnages n’est sauvé, ni, surtout, ne veut l’être… A sa sortie, le film connut un succès énorme, malgré sa radicalité. Oshima réalisera encore un film pour la Shochiku, «Nuit et brouillard au Japon», avant que la Major ne se résolve à le congédier pour «faute grave»!
SEISHUN ZANKOKU MONOGATARI, JAPON, 1960, 1h36, couleur, programme n°151