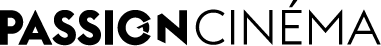Caméra-stylo, programme n°15 |

Les années Bergman»! cette appellation, formulée par un certain Eric Rohmer (du temps où il était un critique remarquable aux Cahiers du Cinéma) désigne une période-clef (1952-1966) dans la carrière du cinéaste suédois: en moins de quinze ans, Ingmar Bergman, révélant une vitalité créatrice exceptionnelle, livre le cinéma à sa modernité la plus passionnante. En huit films, et autant de chefs-d’œuvre, Passion cinéma revient sur ces années essentielles.
Avant que d’entrer dans le vif de ces «années Bergman», examinons brièvement les conditions qui ont permis leur apparition: né en 1918, à Uppsala, conçu par un pasteur luthérien et une mère plutôt dominatrice, Ingmar Bergman grandit dans une famille qui pratique le refoulement des instincts comme une vertu. Meurtri par cette éducation rigoriste, l’enfant emprunte les voies suturantes de l’imaginaire; se projetant corps et âme dans des bouts de films, achetés clandestinement, qu’il passe inlassablement dans le projecteur familial… Ainsi prend forme une vocation de cinéaste!
Cinéma et théâtre
Contraint dans son adolescence à endurer, dimanche après dimanche, les performances oratoires de son père, le jeune Bergman saisit intuitivement le caractère profondément théâtral inhérent à toute vie sociale. «Tout en définitive est théâtre, de la sexualité à nos rapports avec Dieu», déclarera-t-il, des années plus tard.
Cinéma et théâtre… Ingmar Bergman, en alternance, va brûler son existence aux feux de ces deux passions; c’est ainsi qu’il tournera ses films en été et mettra en scène les grands classiques (Ibsen, Shakespeare, Molière, Strindberg, Tennessee Williams, etc.) durant la saison d’hiver, au théâtre municipal de Malmô.
En 1942, Bergman, grâce au succès de l’une de ses propres pièces, est engagé à la Svensk Filmindustri où il passe deux ans à remanier des scénarios; trois ans plus tard, son employeur lui donne l’occasion de diriger un film. Douze autres longs métrages suivront… Affleure déjà l’intention métaphysique qui fera de Bergman le premier cinéaste moderne: le cinéma classique, sûr de son fait, reproduisait la vie, celui de Bergman va la soumettre à la question, sans fournir nécessairement des réponses.
«Les années Bergman»
L’extraordinaire «Nuit des forains» (1953) donne le coup d’envoi des «années Bergman»… Le metteur en scène devient auteur et reflète par pans entiers les inquiétudes qui le rongent, mais donne encore le change: c’est ainsi qu’il se plie à la nécessité d’une histoire dont le spectateur peut s’emparer sans arrière-pensées, emprunte à des types de narration conventionnels (cela dit sans nuance péjorative) tels que le vaudeville («Sourires d’une nuit d’été», 1955) ou l’allégorie («Le Septième sceau», 1957).
Dès lors, deux thèmes, dont Bergman exprimera plus tard le caractère dialectique, vont sans cesse s’entrecroiser: le premier s’efforce à capter l’angoisse d’un monde qui s’interroge sur le sens de l’existence; le second attestant, souvent sur un mode caustique, de la difficulté, voire de l’impossibilité, à communiquer entre homme et femme.
Un cinéaste féministe
L’un et l’autre de ces thèmes vont amener leur auteur à perpétrer, en douceur, sa révolution esthétique: s’interrogeant sur le sens de la vie, Bergman devient un cinéaste du bilan et donc du temps (le cinéma classique était avant tout un art de l’espace); de ce fait, le flash-back devient l’une de ses figures favorites («Les Fraises sauvages», 1957). De même, en voulant rendre compte de l’incommunicabilité au sein du couple, Bergman s’oblige-t-il à considérer la femme comme une entité indépendante de l’homme; cette obligation dramatique fera du Suédois le premier cinéaste réellement féministe et un directeur d’actrices inégalable.
Le cinéma en question
Dès «A travers le miroir» (1961), les «années Bergman» vont prendre une tournure nettement plus radicale: se détournant des récits conventionnels (des modèles issus de la littérature), il met en scène des situations qui, réfléchissant le pouvoir du cinéma, interrogent son statut, ses finalités, ses incapacités. Advient alors la fameuse trilogie, véritable pierre angulaire du cinéma moderne: «Les Communiants» (1963) dénonce indirectement les méfaits de l’illusion de la croyance entretenue par le cinéma classique, «Le Silence» (1963) saborde son penchant à se considérer comme un art de la communication, «Persona» (1966), enfin, réduit à néant la prétention du cinéaste à pouvoir décrire un autre que lui-même.
Le visage comme monde
Le verdict est sans appel: le cinéma est déclaré inapte à éclaircir l’opacité du monde, tout juste peut-il célébrer son mystère. Pour arracher la preuve de ce non-lieu métaphysique, Bergman se voue désormais à l’exploration du seul visage qu’il inscrit, pour mieux s’y confronter, sur des fonds neutres, en aplats; sa caméra traque donc le visage (visage de femme, gage d’indépendance), tente de le percer à jour, de raccorder la surface avec l’intérieur (le grand projet du cinéma), en vain! à force d’approcher, de fixer le visage, d’en désirer le secret, c’est la pellicule qui prend feu («Persona»).
La troupe Bergman
Pareille évolution a été rendue possible par des acteurs et des actrices admirables qui ont formé une véritable troupe de cinéma en acceptant d’enchaîner film sur film; ce faisant, Bibi Andersson, Harriet Andersson, Gunnar Bjômstrand, Erland Josephson, Max von Sydow, Ingrid Thulin et Liv Ullman ont permis à Ingmar Bergman d’œuvrer dans la continuité la plus favorable. Côté équipe technique, l’on a travaillé dans un esprit identique: à l’exemple du chef-opérateur Sven Nykvist qui a signé l’image de la plupart des chefs-d’œuvre des «années Bergman».