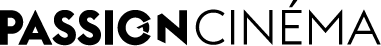A voir lundi 4 septembre 2017 à 21h sur C8 |
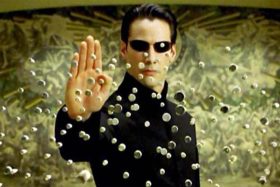
Certes, certes, Andy et Larry Wachowski ont trimé durant près de cinq ans sur le scénario de Matrix, qu’ils ont donc écrit avant de réaliser Bound (1995), leur premier long métrage — une machination saphique ma foi plutôt bien troussée! Mais l’on ne nous empêchera pas de penser que Matrix doit sans doute beaucoup plus à son producteur, Joel Silver, et à son «chorégraphe coordinateur», Yuen Woo Ping. Par son hyperviolence, sa démesure, ce sens de la «démence» visuelle (qui va souvent au-delà de la bêtise de son propos) second long métrage des frangins Wachowski est de toute évidence un produit caractéristique de la Silver Pictures — qui a déjà estampillé par le passé des films tels que «Piège de cristal», «Predator», «L’Arme fatale» ou «Demolition Man».
Question scénario, les Wachowski ont mixé des emprunts à divers matériaux cinématographiques préexistants — dont «La Jetée» de Chris Marker et «Brazil» de Terry Gilliam — tout en puisant dans un fond «philosophique» vieux comme le monde, qu’ils ont apprêté avec de bien fades ingrédients «New Age»… Un simple programmateur travaillant le jour dans un service administratif devient, une fois la nuit venue, un pirate informatique de haut vol œuvrant sous le pseudo de Neo (Keanu Reeves); tripatouillant divers programmes, il reçoit ou «hallucine» des messages cryptés d’un certain Morpheus (Larry Fishburne); ces messages l’enjoignent d’aller, au-delà des apparences, combattre une certaine «matrice» qui nous balancerait des leurres audiovisuels à tire-larigot pour nous empêcher d’accéder à la vérité… Tout ça n’est guère nouveau: depuis l’aube des temps, l’homme ne peut se résoudre à se contenter de la seule réalité, se plaît à penser (tel un Platon) qu’il y a autre chose derrière les apparences qui, dès lors, sont forcément trompeuses… Forts des nouvelles technologies, les deux Wachowski décuplent l’aspect paranoïaque de ce type de méditation en lui donnant un tour plus ou moins vraisemblable. Jetant le trouble sur la réalité qui n’a plus de consistance — l’actuel et le virtuel s’échangent à l’infini, deviennent indiscernables — ils métamorphosent l’espace visuel en un terrain de jeu vidéo où tout peut arriver (voir la scène exemplaire où Neo demande une arme et s’en voit proposer une infinité… au sens littéral du terme).
Bien évidemment, pris dans ce maelström virtuel, les personnages perdent leur primauté, deviennent de purs supports par où doit transiter l’action (comme dans les jeux vidéos justement) — pauvres acteurs américains, ils n’ont plus grand-chose à faire (hormis de la gymnastique) dans ce genre de films «technos» où ils n’ont plus droit à l’expression (à nouveau au sens littéral du terme). Notons aussi que cette sensation de «déréalisation» doit aussi beaucoup aux acrobaties géniales conçues par l’ancien étudiant de l’Opéra de Pékin, Yuen Woo Ping, ex-cascadeur de la Shaw Brothers (Hongkong) et découvreur de Jackie Chan — l’«école» de Hongkong utilisant des harnais et des cables, ce qui accentue l’aspect chorégraphiques des cascades.
The Matrix
de Lana & Andy Wachowski
Etats-Unis, 1999, 2h15