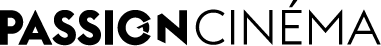Caméra-stylo, programme n°175 |

Pendant des décennies, la salle de cinéma a été considérée comme un lieu de perdition pour des spectateurs égarés. Dès les premiers vagissements du septième art, les ligues de décence se sont mises en état d’alerte et ont noirci des kilomètres de papier en recommandations fébriles et diverses. Au jour d’aujourd’hui, la plupart font sourire, tel ce comminatoire «Il ne sera produit aucun film qui abaisserait les principes moraux de ses spectateurs» et ce tout aussi préventif «Le mal ne doit pas être présenté de manière séduisante» ou encore ce savoureux précepte impossible à tenir: «Le public doit avoir en permanence la certitude que le mal est mauvais et que le bien est bon». Fort heureusement, ces conseils charitables ne furent guère suivis par les cinéastes qui, au sujet des aspirations plus ou moins secrètes de leur public, savaient très bien à quoi s’en tenir. Ce fut donc en pure perte que certains esprits s’échinèrent à faire du cinéma un art sous contrainte morale, atteignant souvent des sommets d’hypocrisie, à l’instar du célèbre Al Capone, un exemple de vertu, qui déclara un jour: «Les films de gangsters font du mal à la jeunesse et n’ont aucune utilité».
Se refaire une santé
Sans conteste, les «films de perdition» ont exercé et exercent toujours un attrait supérieur pour les spectateurs. A croire qu’il n’y a rien de mieux que le spectacle de l’effondrement, de la déréliction et de la chute pour se refaire une santé sur le dos de pauvres personnages subissant moult contrariétés, certes, mais sans que cela n’améliore pour autant notre condition humaine: le réel que nous retrouvons à la sortie du cinéma n’a pas changé. Tout au plus, aura-t-il eu le temps d’empirer… Sauf que, selon le film, notre regard sur lui aura peut-être évolué, se sera chargé d’un supplément d’acuité, de lucidité, de celle qui nous empêche hélas de faire la révolution en sortant du «Voleur de bicyclette» ou des «Quatre cent coups»! Tant mieux, murmureront les comptables des excès révolutionnaires. Dans un ouvrage très recommandé, le philosophe et essayiste Stanley Cavell s’est demandé si, en nous entraînant aussi activement au malheur (des autres), le cinéma nous rendait meilleurs. Ce grand penseur persiste à le croire et il n’a sans doute pas tort…
Un don pour la perdition
Il est clair que l’art cinématographique a le don singulier de nous perdre… Il suffit de voir «Twixt», le dernier film de Francis Ford Coppola pour s’en convaincre, même si maints critiques, peut-être effarouchés par l’audace du vieux cinéaste, ont refusé de s’y aventurer. Formellement, un film peut et devrait toujours tout se permettre: brouiller les temporalités, mêler les niveaux de réalité, casser les genres, réussir à déjouer les attentes (pourtant mille fois théorisées dans les manuels de scénarios abêtissants). C’est pour cette raison que nous chérissons des films «tordus» comme ceux de Jacques Audiard, où nous nous fourvoyons à chaque fois de manière sidérante. Un vieux sage chinois a écrit, il y a des siècles de cela, «qu’il faut se perdre pour comprendre que l’on s’était égaré». Il s’agissait sans doute d’un grand cinéaste avant l’heure!
Vincent Adatte