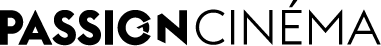Caméra-stylo, programme n°23 |

Né en 1928, à New-York, dans le quartier du Bronx, d’une famille juive américaine originaire d’Europe centrale, Stanley Kubrick connaît durant son adolescence trois passions: les échecs, la photographie et le jazz — enfant, il ambitionne de devenir batteur professionnel. Vers 22 ans, une quatrième passion, le cinéma, supplante les trois autres qui n’en continuent pas moins de produire leurs influences.
Représentant une conjonction idéale entre l’intuition et la rigueur logique, le jeu d’échecs révèle la matrice qui préside à la plupart des scénarios de Kubrick: un trajet à parcourir tout en évitant l’erreur fatale. Grâce à la photographie, le futur auteur de Barry Lyndon développe une science du cadre inégalée, une exigence plastique, qui font de tous ses films un exemple remarquable de cohérence entre forme et contenu. Enfin, du jazz, Kubrick hérite sans nul doute d’un sens du rythme extraordinaire, dont l’influence s’exerce, et sur le montage, et sur le rapport sons/images — ainsi, le cinéaste n’a pas son pareil pour choisir la musique qui convient à telle ou telle séquence.
Un échec providentiel
Au cours de sa jeunesse, entièrement passée dans le quartier qui l’a vu naître, Kubrick vit un événement dont la portée va être considérable: achevant à l’âge de 17 ans sa scolarité obligatoire avec une moyenne médiocre, il ne peut entrer à l’université (où il voulait étudier la physique). Cet échec, d’une part, le contraint à se former en autodidacte, d’autre part accentue son penchant pour l’indépendance. Avec un peu d’audace, l’on peut faire remonter à cette mise à l’écart de l’institution ce désir, plus ou moins conscient, qui pousse Kubrick à réaliser à chaque fois le film-somme, définitif, qui doit constituer la référence pour la postérité — passant d’une genre à l’autre, il s’efforce d’en produire le chef-d’œuvre qui efface tous les autres.
En 1950, Kubrick fait ses débuts de réalisateur en tournant deux courts métrages documentaires consacrés au boxeur poids moyen Walter Cartier et à un prêtre mexicain visitant ses ouailles indiennes en avion; d’emblée, le cinéaste indique combien la représentation méticuleuse, vraisemblable, de la réalité impliquée par ses sujets, lui importera — qu’il s’agisse d’un film à costumes ou de science-fiction. Après ces deux essais, Kubrick passe à la fiction et réalise trois longs métrages dans la tradition du film noir, «Fear and Desire» (1953), «Le baiser du tueur» (1955) et «Ultime razzia» (1956). Le dernier nommé constitue une manière de manifeste de la thématique chère à Kubrick: une bande de gangsters échafaude de manière quasi scientifique un brillant hold-up mais échoue à cause d’une femme trop sentimentale.
Deux ans plus tard, le cinéaste approfondit sa réflexion dans Les sentiers de la gloire; s’attachant à décrire de manière implacable l’issue de la rébellion d’une compagnie de soldats français durant la première guerre mondiale, Kubrick montre l’antagonisme insurmontable qui existe entre une stratégie planifiée et les réflexes instinctifs des soldats.
L’adieu à Hollywood
En 1960 a lieu le grand tournant: reprenant le tournage en cours de Spartacus, Kubrick fait l’expérience de la superproduction hollywoodienne et de tous les compromis que cela suppose. Après quoi, lucide, Kubrick s’exile en Angleterre — où il réside encore actuellement; il démarre alors une seconde carrière avec Lolita (1962), d’après le roman de Nabokov. Grâce à cette brillante démonstration du mauvais commerce que l’homme socialisé entretient avec ses pulsions, Kubrick gagne son indépendance; ce film incompris (par la critique) obtient un succès commercial qui donne confiance aux investisseurs.
Profitant de l’aubaine, le cinéaste organise autour de sa personne un environnement artistique sans ent artistique sans entraves, traite les sujets de son choix, et surtout exerce un contrôle absolu sur toute la chaîne de fabrication du film — jusqu’à faire contrôler les installations techniques des salles diffusant ses œuvres. Fait unique dans l’Histoire du Cinéma, Kubrick réalise dès lors ses grands chef-d’œuvres dans des conditions de confort économique et intellectuel exceptionnelles. Après ce monument de cynisme grinçant que constitue «Docteur Folamour» (1964), il accède à une reconnaissance planétaire avec «2001, Odyssée de l’espace» (1968) qui est sans doute le premier et dernier film expérimental à avoir rencontré le succès.
Prendre son temps
Reconnu, Kubrick prend son temps, multiplie ses exigences de créateur. Résultat, trois ans séparent la réalisation d’«Orange mécanique» (1972) de celle de «Barry Lyndon» (1975); après ce chef-d’œuvre, qui révèle, par le biais de la trajectoire de son personnage principal, combien le siècle des Lumières, par ses idées raisonnables, normatives, trompe l’homme sur son identité profonde, Kubrick met 5 ans pour concevoir «Shining», puis huit ans à accoucher de «Full Metal Jacket» (1988), une variation contemporaine du thème des «Sentiers de la gloire».
Avec une acuité pessimiste, Kubrick décrit la coexistence malaisée d’un cerveau moderne, qui fait sans cesse reculer les limites de nos connaissances, avec un corps resté la proie de ses instincts, de ses «sentiments archaïques» — tous ses films reposent d’une manière ou d’une autre sur la description de cette coexistence à l’issue toujours tragique. Pour exprimer ce conflit, Kubrick a souvent recours au travelling arrière — la caméra recule devant l’acteur qui avance — dont la trajectoire, définie, rectiligne, toute à la fois volontaire mais aveugle, s’oppose formellement aux scénarios circulaires («Orange mécanique», «Shining»), générés par les pulsions qui nous peuplent.
Vincent Adatte