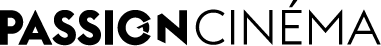En 1995, le cinéaste nippon Mamoru Oshii nous gratifiait du tout premier chef-d’œuvre de «l’anime» japonaise avoir été distribué sous nos latitudes. Tirée d’une célèbre bande dessinée signée par le mythique mangaka Masamune Shirow, cette première adaptation de «Ghost in the Shell» se présentait sous la forme d’un dessin animé sombre et tourmenté au rythme fascinant, se déroulant comme au ralenti.
Quelque vingt ans plus tard, le cinéaste britannique Rupert Sanders, réalisateur de clips remarquables et d’un «Blanche-Neige et le chasseur» (2012) plutôt superfétatoire, en accélère nettement la cadence sous la forme d’une adaptation en live-action, à l’instar de ce que les studios Disney viennent de commettre avec «La belle et la bête». Précisons-le d’emblée, cette nouvelle mouture de «Ghost in the Shell» (GITS pour les initiés) vaut bien mieux que le passage à la moulinette numérique que les héritiers de l’Oncle Walt ont administré au conte moral de Madame Leprince de Baumont!
Dès les premières images, on a le sentiment que Sanders est un admirateur sincère de Mamoru Oshii. Fidèle à la trame de base, il parsème en effet son film de scènes qui font directement référence à son chef-d’œuvre… Rescapée d’un horrible accident, Major (Scarlett Johansson) a été cybernétiquement recomposée. Corps hybride, mi-humaine mi-machine, dotée d’un «ghost» (un esprit artificiel), elle doit traquer un hacker menaçant la sécurité de l’Etat. Au cours de son enquête, Major en vient à soupçonner qu’elle a été elle-même manipulée par l’oligopole techno-totalitaire qui tient lieu de pouvoir en ce très sinistre futur…
N’en disons pas plus, sinon que quelques lieux communs philosophiques (dont une énième citation plan-plan du mythe de la caverne chère à Platon) et une bande-son tonitruante viennent un brin entacher cette dystopie machinique déconnectée de toute réalité tangible. Heureusement pour nous, une armada de fulgurances esthétiques vient sauver la mise! Sans compter l’admirable Scarlett Johansson, laquelle n’a de cesse de léguer son corps sculptural au cinéma de science-fiction, qui l’entraine dans des métamorphoses corporelles répétées. Songeons seulement à «Lucie» de Besson, «Under the Skin» de Jonathan Glazer et «Her» de Spike Jonze, pour ne citer que les plus sidérantes!
de Rupert Sanders
Etats-Unis, 2017, 1h47