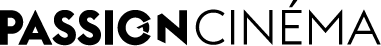Caméra-stylo, programme n°34 |

Pour lancer en toute perfidie cette année commémorative, Passion Cinéma, par le biais de cinq films du cinéaste américain Billy Wilder, rend hommage à une certaine conception du cinéma populaire, aujourd’hui disparue: sans renoncer le moins du monde à sa sensibilité d’auteur, Wilder a en effet été l’un des réalisateurs qui ont rapporté le plus d’argent à Hollywood… A qui et à quoi doit-on ce miracle?
Tentons d’élucider ce qui apparaît, au jour d’aujourd’hui, comme une énigme (un cinéma d’auteur financé et créé à Hollywood); pour ce faire, résumons en premier lieu la carrière fulgurante de Wilder: fils d’un hôtelier, Samuel (dit Billy) Wilder est né en 1906 à Sucha, une petite ville de l’empire austro-hongrois; délaissant ses études de droit, Wilder gagne Berlin où il survit comme danseur mondain et journaliste.
Dès 1927, la société de production allemande UFA l’emploie pour, selon ses propres termes, «polir» des scénarios. En 1927, fait important pour la compréhension de la future œuvre, Wilder participe à l’écriture des «Hommes le Dimanche» (1929), film semi-documentaire où un collectif de jeunes cinéastes allemands (Siodmack, Zinnemann, Ulmer) exécute un tableau vériste de la classe moyenne de l’époque.
Après la prise du pouvoir par les nazis, il se réfugie à Paris où il passe à la mise en scène avec «Mauvaise graine» (1934); dans une faible mais très significative mesure, s’exprime déjà le talent de l’observateur ironique que sera sous peu Wilder — un automobiliste, à qui on a volé sa voiture, retrouve sa plaque d’immatriculation sur le tricycle d’un gosse et crie «au voleur»!
Films noirs et comédies
Entraîné par son compatriote Joe May, Wilder s’exile à Hollywood où il redevient scénariste pour ses compatriotes: on ne dira jamais assez le rôle fondamental que les cinéastes d’origine germanique, au sens large, jouèrent dans le développement du cinéma américain — Von Stroheim, Von Sternberg, Lubitsch, Murnau, Lang, Sirk, Preminger, Siodmak, Dieterle, Zinnemann, Ulmer, Wilder… pour ne citer que les plus connus!
Redevenu scénariste, Wilder collabore à l’écriture des films du créateur de la comédie américaine, Ernst Lubitsch, autrichien comme lui. Il fait alors équipe avec le fameux scénariste Charles Brackett; ce dernier l’encourage à renouer avec la mise en scène selon un processus créatif qui va durer jusqu’en 1950: ils écrivent ensemble le scénario, Wilder dirige, Brackett produit. Ce «circuit court», dès lors qu’il sera couronné de succès, va engendrer une grande indépendance.
Au cours de cette période, le cinéaste réalise 7 films dont l’importantissime «Assurance sur la mort» (1944) qui lance, avec «Le Faucon maltais», réalisé 3 ans auparavant par John Huston, le genre, fameux, du «film noir». A partir de 1959, Wilder entreprend de collaborer avec un nouveau scénariste, d’origine roumaine, I.A.L. Diamond (dont les trois initiales sont, à ce qu’il paraît, purement gratuites); cette nouvelle collaboration inaugure une série de comédies étincelantes (dont Wilder avait appris l’art auprès du «maître» Lubitsch) — «Certains l’aiment chaud» (1959), «La Garçonnière» (1960), «Embrasse-moi idiot» (1964), etc.
L’homme ordinaire du cinéma
En à peu près 50 ans de carrière (son dernier opus, «Buddy Buddy», date de 1981), Wilder a tourné 29 films qui, pour une grande part, ont obtenu un succès populaire. Il doit ce succès durable à plusieurs raisons; la plus évidente réside dans son recours systématique à des personnages «moyens» qui suscitent une large identification: ainsi, dans «Assurance sur la mort», son film noir le plus noir, il remplace à dessein le personnage canonique du détective par un simple agent d’assurance; le mari tenté par Marilyn Monroe dans «Sept ans de réflexion» (1955) est tout ce qu’il y a de plus ordinaire; les deux musiciens contraints à se travestir dans «Certains l’aiment chaud» n’ont rien de génial, etc..
De fait, Wilder appartient à ce courant de jeunes cinéastes américains de l’immédiate après-guerre qui ne renvoient plus l’image d’une société équitable dans laquelle l’individu trouve une place légitime; selon Wilder, l’impératif abstrait de la loi et le système imperturbable de la société sont incapables de réellement prendre en compte ce que l’on appelle la nature humaine; tant dans ses films noirs (qui mettent en pièces l’idéal social rêvé par les cinéastes des années 30) que dans ses comédies des années 50-60, il prend acte avec une ironie terrible (parfois très subversive) de ce divorce que tout un chacun ressent dans sa chair — c’est en cela qu’il est un cinéaste populaire, au sens noble du terme.
La «vraie» Marylin
En plein accord avec son projet, Wilder est bien plus que le dialoguiste époustouflant, fêté du bout des lèvres par la critique «idéologique» de l’époque (qu’elle fût de gauche ou de droite); désireux de mettre à jour l’écart (quasi ontologique mais constamment refoulé) existant entre la société et l’individu, Wilder se devait de matérialiser et dénoncer ce trompe-l’œil permanent que constitue le discours social qui consacre de fausses apparences; cette obligation l’a contraint à élaborer des formes cinématographiques originales, à même de produire cette révélation — dans cet esprit, le saisissant «Boulevard du crépuscule» (1950) dénonce le miroir aux alouettes hollywoodien avec une efficacité autrement plus inquiétante que le récent et très surestimé «Player» signé Altman.
Jamais prise au dépourvu, cette volonté de casser les clichés en vogue explique pourquoi Marylin Monroe n’a jamais joué aussi vrai que dans «Sept ans de réflexion»: prise au piège d’un dispositif narratif qui la dépouille peu à peu de son aura de star, Monroe doit révéler autre chose que le stéréotype dont l’a affublée Hollywood: quelque chose comme son âme ordinaire… Billy Wilder, cinéaste populaire, oui, mais comme il ne s’en fera certainement plus!