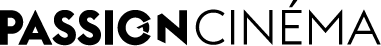Caméra-stylo, programme n°106 |
Dès ses premiers balbutiements, le cinéma a eu maille à partir avec la représentation de la scène de famille. Bien évidemment, le bon Louis Lumière n’avait pas du tout en tête le sens conflictuel que nous prêtons actuellement à cette expression lorsqu’il crut bon d’insérer dans le programme inaugural du 28 décembre 1895 au moins deux films – «Le repas de Bébé» et «La pêche aux poissons rouges» – qui le montraient aux yeux des tout premiers spectateurs dans son intimité familiale petite-bourgeoise. Sept des douze «vues» (comme on disait à l’époque) tournées de sa propre main représentaient la réalité rassurante et édifiante d’une tranquille maisonnée de la fin du XIXe. Au-delà du désir de créer un équivalent animé de l’album de famille, il y avait là sans doute comme le pressentiment du pouvoir de révélation du cinéma, flanqué aussitôt de la volonté naïve d’en conjurer par une représentation «policée» les effets trop véridiques… En futur adepte très sensuel de la devise pétainiste «Travail, famille et patrie», notre brave Lumière aurait sans nul doute été très surpris par le nouveau tour sémantique que le cinéma, «cette invention sans avenir», n’allait pas tarder à administrer à ses si charmantes «scènes». Tout compte fait, il ne l’aurait peut-être pas été autant que cela… Qui sait? La déchéance morale du patriarche de «Festen» lui aurait peut-être même été un brin familière.
Une schizophrénie qui sauve
Par chance, le cinéma, grâce à sa malédiction originaire (à la fois un art et une industrie), a été très vite atteint de schizophrénie galopante. Tandis que de plaisants artisans continuaient à perpétuer la tradition Lumière en produisant à la chaîne des représentations rassurantes de la sacro-sainte famille, quelques francs-tireurs en ont révélé l’envers «cauchemardesque», sinon problématique – c’est sans doute Erich von Stroheim, «L’homme que vous aimerez haïr» (comme le vantaient ses producteurs) qui a ouvert le feu avec «Les rapaces» (1924) et sa scène de mariage inouïe de naturalisme. Aujourd’hui encore, cette curieuse (mais très compréhensible) dichotomie travaille la production cinématographique. Les films soi-disant destinés au grand public persistent à insinuer que tout manquement à la norme – famille monoparentale, concubinage, couple sans enfant, mariage entre homosexuels, etc. — constitue toujours une bizarrerie, voire une affreuse déviance conduisant au désastre, que le scénario «bon papa» se doit de corriger!
Aime ton père et ta mère
Face à cette déferlante moralisante dangereusement névrotique (en regard de l’évolution de notre société qui ne cesse d’«atomiser» la cellule familiale), il importe de soutenir les cinéastes qui persistent à filmer le dissentiment, la dissension, la dispute, la querelle… bref, la scène de famille dans toute sa beauté, la vraie, celle qui nous permet par procuration de «tuer les pères», d’«exécrer les sœurs», de «repousser les mères»… Qu’ils s’appellent Carlos Saura, Thomas Vinterberg, Catherine Breillat, Jacob Berger, Alejandro Amenábar ou Philippe Faucon, ces cinéastes nous sont des plus précieux, parce que leurs films éclatants de santé équivoque contribuent à ce qu’il ne reste plus rien (ou presque) des liaisons et des agrégats funestes engendrés par les traditions et les chimères d’hier. C’est une manière comme une autre de tenter «de désarmer le vieux destin, afin que le cauchemar des générations précédentes ne se reporte pas sur les hommes d’aujourd’hui (Peter Sloterdijk)».
Vincent Adatte